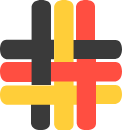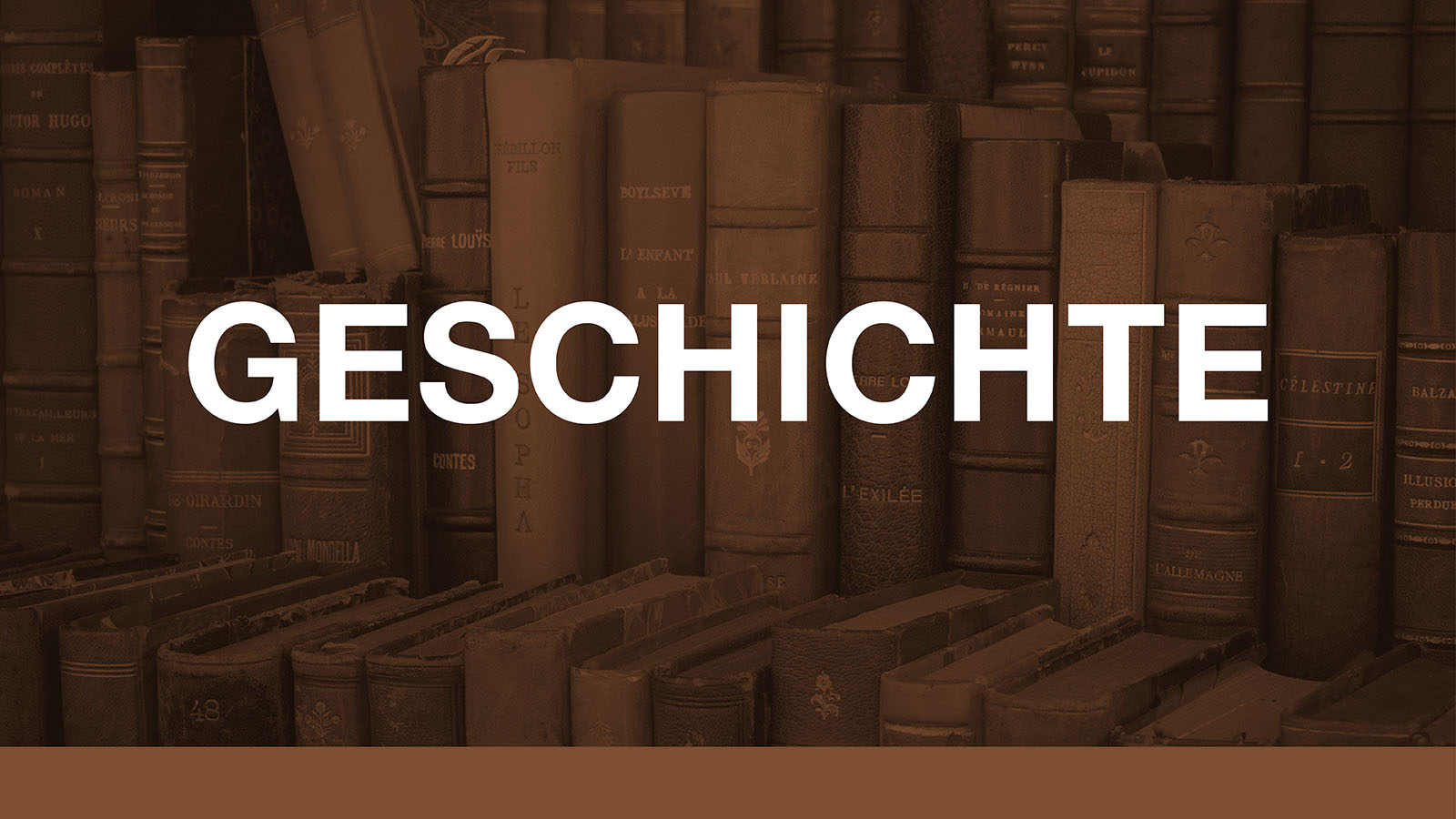
La Révolution brabançonne et les États belgiques unis (1789-1795) : Émergence d'un caractère national belge ? – Partie 1
Cet article retrace les évènements révolutionnaires qui secouèrent les Pays-Bas autrichiens entre 1789 et 1795, de la Révolution brabançonne, les Etats-Belgiques-Unis à l’annexion française. Il examine comme cause de ces évènements les réactions des institutions locales face aux réformes centralisatrices politiques et religieuses de Joseph II. Ensuite, il les compare aux révolutions française et américaine pour essayer de déterminer si ces évènements « belges » sont de simples soubresauts ou l'expression d'un caractère belge complexe et conservateur
Introduction
Considérons tout d’abord la place qu’occupe la Révolution brabançonne dans l’historiographie. Les historiens s’intéressent à cette révolution en deux grandes vogues distinctes. D’une part, une première fois avant la Seconde Guerre mondiale dont les publications sont souvent « patriotiques » et datées. D’autre part, une période initiée à partir des années 1980 qui adopte une approche soucieuse de la critique historique. Après les années 1990, Les ouvrages deviennent plus rares.[1] En conséquence, les sources de cette révolution, comme les pamphlets, restent mal connues. Peu d’inventaires détaillés existent, si bien que certains documents d’archives restent encore inédits.[2]
Actuellement, la Révolution brabançonne est très largement négligée, tant par les historiens que par le système scolaire belge, au profit de la Révolution française.[3] Cette dernière, plus étendue (sur 10 ans) et aboutissant à l’Empire français est jugé un évènement plus marquant et plus facile à enseigner. D’où vient cette perception que la Révolution brabançonne n’est pas intéressante ? C’est parce qu’elle souvent perçue comme secondaire dans l’historiographie, n’ayant été qu’une « révolte courte et régressive mal mené par les derniers des moines et aristocrates fanatiques ».[4] Et surtout : elle n’a pas laissé de traces sur la formation de l’Etat belge du XIXe siècle. Alors, était-elle sans importance ?

[Description Image : Hendrik van den Beeck, Caricature de la Bataille de Falmagne de 28 Septembre 1790, Aachen, 1790, Bibliothèque Nationale de France, URL: https://gallica.bnf.fr/iiif/ark:/12148/btv1b6944485p/f1/full/full/0/native.jpg
La Bataille de Falmagne, qui se déroule lors de la Révolution brabançonne, commence le 22 septembre 1790 par l'attaque des révolutionnaires belges. Environ 5 000 insurgés se lancent à l’assaut contre plusieurs milliers de soldats autrichiens, commandés par les généraux Schönfeld et Koehler. Malgré la mobilisation massive de villageois, cette bataille se soldera par un échec pour les troupes révolutionnaires, marquant ainsi un tournant dans la reconquête autrichienne de ses territoires perdus. Ce qui rend cette peinture particulièrement intéressante, c'est qu’elle prend la forme d’une caricature. À gauche, on y voit une armée autrichienne disciplinée, formée en lignes de bataille, opposée à un amalgame chaotique de paysans, moines et aristocrates, loin d’être de véritables soldats. De plus, ces derniers se battent au sabre contre des fusils, ce qui accentue l’idée de la futilité de ces troupes révolutionnaires face à la supériorité militaire autrichienne.
Cette vision sous-estimée de la Révolution brabançonne semble prendre racine à son époque, au XVIIIe siècle, mais il faut éviter de confondre les buts de cette révolution avec celle de la future nation belge. Les enjeux étaient différents. Des critiques contemporaines qualifient cette Révolution de « ridicule contre-révolution ». Ces jugements proviennent de voyageurs ou « journalistes » étrangers comme Pierre Lebrun, éditeur du Journal d’Europe, qui voyait en Joseph II un véritable révolutionnaire dont les réformes ont été étouffées. Le français Camille Desmoulins, quant à lui, décrit la Révolution brabançonne comme « une sorte absurde de peuple oriental dont la raison sommeillant ne progresse jamais et dont l’esprit comme la bière restaient exactement les mêmes d’année en année. »[5] La « condamnation » de cette révolution semble être liée à son caractère curieux, quasi « non national ». C’est une constatation qui fait demander quelle était le caractère de cette révolution.
Cet article vise à nuancer la vision réductrice de la Révolution brabançonne en montrant que, bien que locale, elle est tout aussi pertinente pour comprendre la Belgique que la Révolution française ne l’est pour la France. Il s’agit de mettre en lumière ses spécificités propres, tout en la comparant aux révolutions française et américaine. Cette étude interroge donc : la Révolution brabançonne et les États-Belgiques-Unis relèvent-ils d’un mouvement progressiste, ou d’une réaction conservatrice révélant l’émergence d’un caractère national belge ? Une première partie présentera les institutions traditionnelles et leur caractère, ainsi que les réformes de Joseph II. Une deuxième partie élaborera les réactions autour des réformes de Joseph II et le déroulement de la Révolution brabançonne et des liens aux autres révolutions dans cette dernière. Enfin, le troisième chapitre présentera l’avènement et la chute des Etats-Belgiques-Unis, avant de discuter le caractère belge fortement présent dans la Révolution brabançonne et les Etats-Belgiques-Unis.
Pour mener cette recherche, on s’appuiera à la fois sur les résultats d’études antérieures et sur un corpus de documents d’archives issus des institutions des Pays-Bas autrichiens en 1787. L’approche repose sur l’analyse du contenu et de la chronologie d’un grand nombre de textes, en particulier les Recueils des protestations et réclamations faites à Joseph II(tomes 1, 2 et partie 5 du tome 2), compilés par F.-X. Feller. On mobilisera également l’ouvrage intitulé Considérations sur la constitution des duchés de Brabant et de Limbourg, et des autres provinces des Pays-Bas autrichiens, publié le 23 mai 1787 et présenté à l’Assemblée générale des États de Brabant. Ces sources éditées sont précieuses pour comprendre les réactions aux réformes modernisatrices de Joseph II. Elles révèlent un rejet profondément ancré dans des valeurs religieuses et traditionnalistes qui mènera à la révolte armée.
Cette première partie se propose d’examiner les caractéristiques politiques, sociales, religieuses et institutionnelles des Pays-Bas autrichiens dans les décennies qui précèdent les réformes de Joseph II. Entité périphérique de la monarchie des Habsbourg, mais dotée d’un fort particularisme, cette région présente une organisation territoriale complexe, une autonomie juridique marquée, et une répartition du pouvoir entre les trois ordres. À cela s’ajoute un profond attachement au catholicisme, qui imprègne aussi bien la vie publique que les structures locales. En analysant ces éléments, il s’agira de mieux comprendre comment cette configuration singulière a contribué à façonner une identité politique propre, souvent en tension avec les ambitions centralisatrices et modernisatrices de Vienne.
Les Pays-Bas autrichiens, correspondant à l’actuelle Belgique (à l’exception des territoires de la principauté épiscopale de Liège), constituaient une entité institutionnelle spécifique au sein de la monarchie autrichienne avec une position assez autonome.
[Description d’image : Carte montrant les Pays-Bas autrichiens et leurs provinces, tels qu'en 1789. D'après : * Carte : Faden, William "A map of the Austrian possessions in the Netherlands or Low Countries (1789), sur David Rumsey Map collection; * Flandre rétrocédée : Delisle, Guillaume "Carte du Comté de Flandre (1704), sur Gallica.bnf.fr., URL : https://belgien.net/belgien-im-18-jahrhundert-die-oesterreichische-zeit
Les Pays-Bas autrichiens comprenaient dix entités territoriales, dites provinces, parmi lesquelles les plus influentes étaient les duchés de Brabant, Luxembourg et Limbourg (rattaché au Brabant), les comtés de Hainaut, Flandre et Namur, ainsi que des enclaves comme les seigneuries de Malines et de Tournai-Tournaisis.[6] Chaque province disposait de son propre droit coutumier, quelques même d’une constitution propre, d’un système judiciaire distinct et de conseils dirigés (normalement) par ces trois ordres : Noblesse, Clergé et Tiers État (en Brabant composé des villes principales). Le duché de Brabant se distinguait par une autonomie politique et administrative affirmée, garantie par la Joyeuse Entrée de 1356, un acte fondamental limitant le pouvoir du souverain et la compétence des institutions centrales dans le Brabant.[7] Le Conseil de Brabant y assurait l’autorité judiciaire, indépendamment du Grand Conseil de Malines, et veillait à la préservation des anciennes libertés. Bruxelles, capitale du duché, était aussi celle des Pays-Bas autrichiens. Ces circonstances donnaient une prééminence au Brabant qui va jouer un rôle dans l’époque nationale.
Toutefois, la véritable particularité de tous ces territoires réside dans leur profond attachement au catholicisme. Voltaire, après un séjour dans les années 1740, qualifiait cette empreinte religieuse d’« état d’ignorance profonde ». [8] Des commentaires péjoratifs d’un étranger sans doute, mais aux Pays-Bas le Catholicisme était étroitement liée aux institutions profanes. Les institutions ecclésiastiques et le clergé sont omniprésents, notamment au niveau local, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : prêtres, moines et nonnes représentent au moins 1 % de la population, et jusqu’à 7 % des adultes dans les grands centres urbains. La population manifeste une grande affection pour les religieux engagés auprès des pauvres et des malades, et se méfie de ceux vivant dans le luxe. [9] Les Jésuites et leurs écoles étaient aussi présents. Cet attachement au Catholicisme s’explique en partie par la politique de Contre-Réforme menée par les Espagnols après les conflits confessionnels du XVIe siècle. Par ailleurs, ces provinces, éloignées du centre impérial viennois, géraient leurs affaires dans des langues locales, renforçant leur particularisme.[10]
L'Empereur, membre de la famille des Habsbourg autrichiens, exerce son pouvoir de manière héréditaire sur les Pays-Bas autrichiens,[11] mais il n’est jamais présent. Au lieu de cela, il est représenté par un gouverneur général. À partir de Marie-Thérèse, les gouverneurs perdent de leur influence direct au profit d’un ministre plénipotentiaire à cause d’un effort croissant d’intégrer les Pays-Bas institutionnellement dans la monarchie autrichienne.[12] Toutefois, ces réformes ont longtemps été graduelles, voire discrètes.
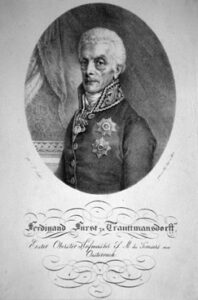
[Description d’image : Lithographie de Ferdinand von Trauttmansdorff (1749-1827), ministre plénipotentiaire sous Joseph II, par Friedrich Lieder, ca. 1859, Wikicommons, URL : https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ferdinand_Trauttmansdorff_Lithographie.jpg]
Joseph II (1741-1790), fils aîné de François Ier et de Marie-Thérèse d’Autriche, frère de Marie-Antoinette et de Léopold II, devient empereur du Saint-Empire et corégent des États des Habsbourg en 1765, mais ne gouverne seul qu’après la mort de sa mère, en 1780.[13] Contrairement à Marie-Thérèse, plutôt restée dans la tradition de gouvernement et respectueuse des traditions et appréciée dans les Pays-Bas autrichiens, Joseph II adoptera une approche plus rationnelle et réformatrice.[14] On peut dire qu’il était saisi par le « Zeitgeist » de son époque.
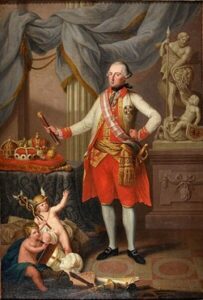
[Description d’image : Portrait de Joseph II, peinture à l’huile par Jean-Herman Faber, WikiCommons, URL : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Portrait_of_Joseph_II_of_Austria.jpg]
La politique et la philosophie de Joseph II s’inscrivent dans le courant du despotisme éclairé qui se répand à la fin du XVIIIe siècle, tout en présentant des spécificités propres. Il incarne la figure de l’« empereur philosophe », un véritable « despote éclairé » inspiré des Lumières. Ce mouvement, centré sur la Raison et les droits naturels, entend éveiller les peuples par la connaissance et par force – s’il est nécessaire. Descartes, en parlant de « lumière naturelle », évoque déjà cette capacité innée à raisonner librement.[15] Le despotisme éclairé, héritier de l’absolutisme louis-quatorzien et croisé avec l’idée de transformer le monde selon des principes rationnels, influence plusieurs monarchies européennes (Espagne, Prusse, Russie, Empire autrichien). Il vise à réformer la société ; abolition de la torture, promotion de la science, modernisation des institutions. Joseph II adopte pleinement cette vision, mais développe une ligne propre, le « joséphisme », marquée par une volonté de réduire l’influence de l’Église. Il interdit les bulles papales, dissout des monastères, impose des édits de tolérance religieuse, réforme l’éducation et libéralise la censure. Il impose également l’allemand comme langue administrative, ce qui suscite de fortes tensions, notamment en Hongrie et dans les Pays-Bas autrichiens.[16] Sur le plan économique, il abolit le servage, les corvées, et soumet la noblesse à l’impôt foncier.[17] Dès 1771, sur le plan religieux, il considère le clergé comme inefficace et rétrograde, qualifiant les sujets de sa mère d’« incultes », encadrés par un clergé « idiot », prisonnier d’une superstition généralisée.[18]
En 1781, Joseph II visite incognito les Pays-Bas autrichiens pour observer la réalité locale, mais son regard reste sévère. Convaincu de la nécessité des réformes, il les impose avec fermeté, déclenchant une vive opposition. Dans sa correspondance, il confesse l’ampleur de la tâche et la solitude du pouvoir.[19] Il est conscient des résistances. Il meurt en 1790, usé et désillusionné. Son épitaphe résume le paradoxe de son règne : « Ici repose un prince dont les intentions étaient pures, mais qui eut la malchance de voir tous ses plans tomber à l’eau. [20] »
Conclusion de la première partie
L’analyse des structures politiques, sociales et religieuses des Pays-Bas autrichiens à la veille des réformes de Joseph II est essentielle à la compréhension des origines de la Révolution brabançonne, car elle révèle une société profondément enracinée dans ses traditions institutionnelles et son autonomie locale. La tentative de réforme radicale menée par un empereur éclairé mais maladroit entre en collision avec une organisation politique fragmentée, un catholicisme omniprésent et un attachement viscéral aux privilèges anciens. Ces tensions latentes jettent les bases d’une opposition déterminée, marquée par sa résistance au changement, et nourrissent les dynamiques révolutionnaires brabançonnes. Ces particularismes permettent ainsi de mieux saisir l’originalité et les motivations profondes d’un mouvement qui, bien que souvent relégué au second plan, porte en germe une forme d’affirmation identitaire propre aux anciens Pays-Bas.
[1] GODFROID, S., La mobilisation de la population des Pays-Bas autrichiens lors des événements révolutionnaires de 1789 à 1794, UCLouvain, 2019, p. 5.
[2] VERCRUYSSE, J., Les pamphlets de la Révolution belge (1787-1791) et les Lumières philosophiques, dans Revue belge de philologie et d'histoire, t. 91, 2013, p. 317.
[3] POLASKY, J., The Brabant Revolution, « a Revolution in Historiographical Perception », dans Revue belge d’histoire contemporaine, t. 35, n°4, 2005, p. 435.
[4] Ibid., p. 435.
[5] Ibid., p. 435-436, 443.
[6] DAVIS, W-W., Joseph II : an imperial reformer of the Austrians Netherlands, The Hage, 1974, p. 15.
[7] Ibid., p. 28 ; VAN DER MERSH, F-M., La Révolution Belgique : Chronique d’une famille entre France et Flandres, Bruxelles, 2000, p. 110 ; VALLAUD, D., Dictionnaire historique, s.l. 1995, p. 109.
[8] VANTHEMSCHE, G. et DE PEUTER, R., A Concise History of Belgium, Cambridge, 2023, p. 188-189.
[9] Ibid., p. 188-189.
[10] BEALES, D., Joseph II : Against the world (1780-1790), vol. 2, Cambridge, 2009, p. 133.
[11] DE MOREAU GERBEHAYE, C., Les institutions du Gouvernement Central des Pays-Bas Habsbourgeois (1482-1795), t. 1, Bruxelles, 1995, p. 39-41.
[12] Ibid., p. 198.
[13] VALLAUD, D., Dictionnaire historique, p. 503-504.
[14] GERARD, J., Quand la Belgique était autrichienne, Bruxelles, 1976, p. 121.
[15] BLUCHE, F., Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, 2005, p. 919-920.
[16] Ibid., p. 467-468 ; VALLAUD, D., Dictionnaire historique, p. 283 ; BEALES, D., Joseph II : In the shadow of Maria Theresa (1741-1780), vol.1, Cambridge, 2008, p. 439.
[17] VALLAUD, D., Dictionnaire historique, p. 503-504.
[18] BEALES, D., In the shadow of Maria Theresa, p. 452.
[19] GERARD, J., Quand la Belgique, p. 126.
[20] BLANNING, T-C-W., Joseph II, London, 1994, p. 1.